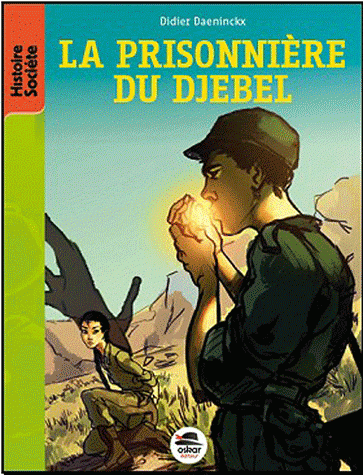|
| Didier Daeninckx © Jacques Sassier |
Nous sommes en 2011. Eric, le narrateur de La Prisonnière du Djebel, le roman jeunesse de Didier Daeninckx (lire ici sa présentation), est un jeune informaticien. Gilbert, son grand-père, partage sa vie entre une vieille masure isolée proche de son village natal et l’appartement H.L.M. qu’il continue de louer en banlieue parisienne, à Montreuil. Éric, auquel Gilbert a prêté l’appartement, y trouve par hasard une boîte dont le contenu intriguant le conduira à mener une véritable enquête auprès de son grand-père… Ce court texte, récit historique dans le contexte d’années longtemps tues, celles de la guerre d’Algérie, quasi polar marqué par le souvenir comme le sont souvent les grands romans noirs, livre de la désobéissance qui sauve l’homme, est aussi beaucoup d’autres choses à découvrir par tous de 12 à 112 ans. Un style vivant, incisif, parfois elliptique, jamais pontifiant, aux dialogues forts, un fonds universel où se côtoient grandeur et quotidienneté et où Didier Daeninckx prend le parti de ceux qui se rebellent, et pas seulement des «rebelles» algériens qui se battaient pour leur terre et leur honneur.
GÉGÈNE: La guerre d’Algérie et ses conséquences prennent une part importante dans votre œuvre pratiquement dès vos premiers romans, pour adultes Meurtres pour mémoire et pour plus jeunes Le Chat de Tigali. Pourquoi?
DIDIER DAENINCKX: J’ai écrit Meurtres pour mémoire, mon deuxième roman, en 1983 pour me démarquer d’une sorte de silence qui pesait sur la société française, et qui était lié en partie à des épisodes de la guerre d’Algérie qui ont eu lieu en France. L’élément fondateur de mon intérêt pour cette guerre, ce sont des souvenirs d’enfance et de préadolescence et, surtout, les événements du métro Charonne. Une amie de ma mère, habitante de notre cité à Aubervilliers, a été l’une des huit personnes tuées au soir de ce 8 février 1962. J’allais au même collège que ses enfants et j’ai participé à l’enterrement qui regroupait pratiquement 500 000 personnes. Ces événements m’ont profondément marqué et de ce fait, en 1997, j’ai assisté, totalement médusé et révolté, à l’arrivée de Maurice Papon au gouvernement, en tant que ministre du budget. Préfet à l’époque de Charonne, il était pour moi le responsable direct de la mort de ma petite voisine. Outre cette mort, si la guerre d’Algérie est au cœur de mon enfance, c’est qu’il y avait alors chaque semaine, à Aubervilliers, une manif pour la paix en Algérie. Pas mal de jeunes de la ville avaient été appelés en Algérie, un certain nombre y ont été blessés et une dizaine y sont morts. À chaque fois, il y avait enterrement et manifestation. Enfin, dans la cour du collège, il y avait des bagarres entre gamins, ceux qui étaient pour l’Algérie française, ceux qui étaient pour l’indépendance, et les jeunes Algériens. Car, dans les années 60, Aubervilliers était une ville très mélangée. D’un côté il y avait une forte immigration, en particulier une immigration algérienne, principalement kabyle. De l’autre, il y avait la présence d’une petite et moyenne bourgeoisie très organisées et de l’église. Cette guerre a donc en quelque sorte rythmé mon enfance et ma préadolescence.
DIDIER DAENINCKX: J’ai écrit Meurtres pour mémoire, mon deuxième roman, en 1983 pour me démarquer d’une sorte de silence qui pesait sur la société française, et qui était lié en partie à des épisodes de la guerre d’Algérie qui ont eu lieu en France. L’élément fondateur de mon intérêt pour cette guerre, ce sont des souvenirs d’enfance et de préadolescence et, surtout, les événements du métro Charonne. Une amie de ma mère, habitante de notre cité à Aubervilliers, a été l’une des huit personnes tuées au soir de ce 8 février 1962. J’allais au même collège que ses enfants et j’ai participé à l’enterrement qui regroupait pratiquement 500 000 personnes. Ces événements m’ont profondément marqué et de ce fait, en 1997, j’ai assisté, totalement médusé et révolté, à l’arrivée de Maurice Papon au gouvernement, en tant que ministre du budget. Préfet à l’époque de Charonne, il était pour moi le responsable direct de la mort de ma petite voisine. Outre cette mort, si la guerre d’Algérie est au cœur de mon enfance, c’est qu’il y avait alors chaque semaine, à Aubervilliers, une manif pour la paix en Algérie. Pas mal de jeunes de la ville avaient été appelés en Algérie, un certain nombre y ont été blessés et une dizaine y sont morts. À chaque fois, il y avait enterrement et manifestation. Enfin, dans la cour du collège, il y avait des bagarres entre gamins, ceux qui étaient pour l’Algérie française, ceux qui étaient pour l’indépendance, et les jeunes Algériens. Car, dans les années 60, Aubervilliers était une ville très mélangée. D’un côté il y avait une forte immigration, en particulier une immigration algérienne, principalement kabyle. De l’autre, il y avait la présence d’une petite et moyenne bourgeoisie très organisées et de l’église. Cette guerre a donc en quelque sorte rythmé mon enfance et ma préadolescence.
Intervenez-vous dans des classes et y rencontrez-vous des jeunes issus de l’immigration algérienne?
Oui, énormément.
Oui, énormément.
Avez-vous l’impression qu’ils savent ce que fut cette guerre?
Non. Du côté algérien aussi, il y a eu beaucoup de silence, c’est très compliqué. Pour eux aussi cela a été, pour une part, une guerre civile. Guerre entre les premiers indépendantistes légitimes, le M.N.A. autour de Messali Hadj, et le F.L.N. Le M.N.A .a été pratiquement rayé de la carte par le F.L.N. dans une guerre civile qui s’est passée pour grande partie en France, dans le nord et dans l’est puis dans les bidonvilles autour de Paris. Cela représente plusieurs milliers de morts dans une lutte interne pour le pouvoir, la conduite de la révolution et la marche vers l’indépendance. Plus tard, se produisent les événements du 17 Octobre 1961; la direction du F.L.N. les a utilisés pour discréditer et mettre de côté sa fédération en France, l’accusant d’être à l’origine des morts qui ont fait suite à la manifestation qu’elle avait organisée (ndlr: lire la bande dessinée de Didier Daeninckx et Mako Octobre noir aux éditions Ad Libris). Puis il y a, à la fin de la guerre, le massacre des Harkis qui est une tache sur la révolution algérienne, et sur l’armée française qui a totalement abandonné ses combattants algériens en sachant parfaitement ce qui allait se produire. En Juillet 1962, au moment de la signature des accords avec la France, il y a aussi une guerre intestine qui conduira plus tard, en 1965, à la prise de pouvoir par coup d’état de Boumedienne. Ajoutons à cela la mise de côté des Kabyles, en particulier de certains des dirigeants de la lutte armée comme Aït Ahmed. Toutes ces pesanteurs coexistent et pèsent sur la société algérienne. Beaucoup chez les Algériens, en particulier chez les aînés, privilégient dans leur récit le combat pour l’indépendance contre la France et occultent les luttes internes. L’ensemble crée une ignorance quasi totale chez les jeunes. Nous sommes donc face à une guerre qui a laissé des deux côtés un tas de traces, toujours embarrassantes cinquante ans après sa fin et empêchant d’accéder à toutes les vérités.
Non. Du côté algérien aussi, il y a eu beaucoup de silence, c’est très compliqué. Pour eux aussi cela a été, pour une part, une guerre civile. Guerre entre les premiers indépendantistes légitimes, le M.N.A. autour de Messali Hadj, et le F.L.N. Le M.N.A .a été pratiquement rayé de la carte par le F.L.N. dans une guerre civile qui s’est passée pour grande partie en France, dans le nord et dans l’est puis dans les bidonvilles autour de Paris. Cela représente plusieurs milliers de morts dans une lutte interne pour le pouvoir, la conduite de la révolution et la marche vers l’indépendance. Plus tard, se produisent les événements du 17 Octobre 1961; la direction du F.L.N. les a utilisés pour discréditer et mettre de côté sa fédération en France, l’accusant d’être à l’origine des morts qui ont fait suite à la manifestation qu’elle avait organisée (ndlr: lire la bande dessinée de Didier Daeninckx et Mako Octobre noir aux éditions Ad Libris). Puis il y a, à la fin de la guerre, le massacre des Harkis qui est une tache sur la révolution algérienne, et sur l’armée française qui a totalement abandonné ses combattants algériens en sachant parfaitement ce qui allait se produire. En Juillet 1962, au moment de la signature des accords avec la France, il y a aussi une guerre intestine qui conduira plus tard, en 1965, à la prise de pouvoir par coup d’état de Boumedienne. Ajoutons à cela la mise de côté des Kabyles, en particulier de certains des dirigeants de la lutte armée comme Aït Ahmed. Toutes ces pesanteurs coexistent et pèsent sur la société algérienne. Beaucoup chez les Algériens, en particulier chez les aînés, privilégient dans leur récit le combat pour l’indépendance contre la France et occultent les luttes internes. L’ensemble crée une ignorance quasi totale chez les jeunes. Nous sommes donc face à une guerre qui a laissé des deux côtés un tas de traces, toujours embarrassantes cinquante ans après sa fin et empêchant d’accéder à toutes les vérités.
Question plus générale. Comment êtes-vous entré en littérature jeunesse?
C’est un hasard incroyable. J’étais au marché à la mairie d’Aubervilliers, une jeune femme m’arrête, me demande si je suis bien Didier Daeninckx et me dit alors qu’elle est institutrice dans l’école primaire où j’ai été élève, et qu’il y a des traces de mon passage dans la classe où elle enseigne. Elle me demande si j’accepte de venir participer à un atelier d’écriture. Je ne peux pas refuser de retourner dans «ma» classe. J’y vais, j’anime l’atelier où les enfants élaborent un texte, et j’en écris un moi-même en parallèle. Tout ça est exposé à l’époque, en 1986, à la bibliothèque d’Aubervilliers. Sa directrice était au courant qu’une maison d’édition pour la jeunesse, Syros, se créait avec la naissance d’une collection de polars courts, Souris Noire. Elle leur envoie le texte que j’avais écrit en parallèle de l’atelier avec les élèves. Quinze jours plus tard je reçois un appel de Joseph Périgot, directeur de la collection: «j’ai lu ton texte, on l’édite». C’est ainsi que fut publié mon premier texte pour la jeunesse, La Fête des mères! La suite, je la dois à un intellectuel de haut niveau, alors ministre de l’intérieur, Charles Pasqua, qui avait le projet hautement respectable de moraliser la littérature jeunesse. Cela valut à mon roman de figurer, parmi d’autres, dans une liste d’ouvrages nonecommandables, et dans une expo qui leur était consacrée, Place Beauvau. Je me suis donc retrouvé, pour un texte très gentil et édité un peu par hasard, dans une espèce de mouvement fou qui m’a conduit à me battre pour le défendre. On faisait courir le bruit que mon livre était interdit, certains libraires ne souhaitaient plus le présenter, une association, Sang de la terre, dirigée par une madame Marie-quelque chose Monchaux organisait des meetings appelant à la censure de ces ouvrages… Je publiais des livres comme Meurtres pour mémoire à la Série Noire, qui étaient des bombes, et je n’ai jamais eu le centième des ennuis créés par la publication de La Fête des mères! Ça m’a révulsé, tout ce qui se passait autour d’un texte que j’avais écrit pour les quelques mômes d’une classe! Je me suis dit alors que s’il y avait de tels enjeux autour de la littérature pour la jeunesse, il fallait que je continue… et j’ai écrit Le Chat de Tigali. On était en 1986-87, on commençait à aborder des thèmes nouveaux en littérature jeunesse avec la maladresse qui peut accompagner l’exploration de nouveaux champs: provocation, méconnaissance des relations avec les jeunes lecteurs fondées sur la confiance… Mais cette évolution était nécessaire, les enfants ont besoin que ce à quoi ils sont de plus en plus souvent confrontés, explosion du couple, prison… soit sublimé par la littérature. Il faut en parler, trouver les moyens d’en parler tout en construisant une fiction. C’est grâce à Charles Pasqua et Marie-machin Monchaux que j’ai continué à consacrer une partie de mon temps à l’écriture pour la jeunesse, et je les en remercie!
C’est un hasard incroyable. J’étais au marché à la mairie d’Aubervilliers, une jeune femme m’arrête, me demande si je suis bien Didier Daeninckx et me dit alors qu’elle est institutrice dans l’école primaire où j’ai été élève, et qu’il y a des traces de mon passage dans la classe où elle enseigne. Elle me demande si j’accepte de venir participer à un atelier d’écriture. Je ne peux pas refuser de retourner dans «ma» classe. J’y vais, j’anime l’atelier où les enfants élaborent un texte, et j’en écris un moi-même en parallèle. Tout ça est exposé à l’époque, en 1986, à la bibliothèque d’Aubervilliers. Sa directrice était au courant qu’une maison d’édition pour la jeunesse, Syros, se créait avec la naissance d’une collection de polars courts, Souris Noire. Elle leur envoie le texte que j’avais écrit en parallèle de l’atelier avec les élèves. Quinze jours plus tard je reçois un appel de Joseph Périgot, directeur de la collection: «j’ai lu ton texte, on l’édite». C’est ainsi que fut publié mon premier texte pour la jeunesse, La Fête des mères! La suite, je la dois à un intellectuel de haut niveau, alors ministre de l’intérieur, Charles Pasqua, qui avait le projet hautement respectable de moraliser la littérature jeunesse. Cela valut à mon roman de figurer, parmi d’autres, dans une liste d’ouvrages nonecommandables, et dans une expo qui leur était consacrée, Place Beauvau. Je me suis donc retrouvé, pour un texte très gentil et édité un peu par hasard, dans une espèce de mouvement fou qui m’a conduit à me battre pour le défendre. On faisait courir le bruit que mon livre était interdit, certains libraires ne souhaitaient plus le présenter, une association, Sang de la terre, dirigée par une madame Marie-quelque chose Monchaux organisait des meetings appelant à la censure de ces ouvrages… Je publiais des livres comme Meurtres pour mémoire à la Série Noire, qui étaient des bombes, et je n’ai jamais eu le centième des ennuis créés par la publication de La Fête des mères! Ça m’a révulsé, tout ce qui se passait autour d’un texte que j’avais écrit pour les quelques mômes d’une classe! Je me suis dit alors que s’il y avait de tels enjeux autour de la littérature pour la jeunesse, il fallait que je continue… et j’ai écrit Le Chat de Tigali. On était en 1986-87, on commençait à aborder des thèmes nouveaux en littérature jeunesse avec la maladresse qui peut accompagner l’exploration de nouveaux champs: provocation, méconnaissance des relations avec les jeunes lecteurs fondées sur la confiance… Mais cette évolution était nécessaire, les enfants ont besoin que ce à quoi ils sont de plus en plus souvent confrontés, explosion du couple, prison… soit sublimé par la littérature. Il faut en parler, trouver les moyens d’en parler tout en construisant une fiction. C’est grâce à Charles Pasqua et Marie-machin Monchaux que j’ai continué à consacrer une partie de mon temps à l’écriture pour la jeunesse, et je les en remercie!
Vous sentez- vous plus responsable quand vous écrivez pour la jeunesse? Écrivez-vous différemment?
Non, je ne me sens pas plus responsable. Oui, mon écriture est différente, c’est évident. Pas mal de gens que je rencontre autour du monde de l’enfance me disent «Vos bouquins sont compliqués, leur structure, retours en arrière, vocabulaire, construction…» Mais c’est ma manière et ça a l’air de passer, Le Chat de Tigali qui est presque devenu un classique contemporain le montre. La principale différence que je vois, quand j’écris pour Syros ou Rue du Monde, c’est que mon écriture est plus métaphorique et beaucoup plus poétique. Des problèmes que je résous par les dialogues ou d’autres procédés dans mes livres pour adultes, là je les résous par un autre travail sur le langage. C’est aussi en partie le résultat de mes souvenirs de mes lectures enfantines. Les livres lisses n’ont pas laissé de trace, les livres où il y avait d’un seul coup irruption d’incompréhension, d’inconnu sont ceux qui sont restés; des livres compliqués, des phrases sibyllines, des mots dont on se demande ce qu’ils veulent dire… Le mystère n’est pas simplement dans l’intrigue, il est aussi dans les mots, les phrases, la langue. C’était pour moi un bonheur de découvrir l’Inde, Madagascar ou d’autres contrées par des contes et légendes où apparaissaient des mots pratiquement imprononçables pour le gamin que j’étais. À l’occasion de ces lectures, je découvrais, et je pense que les lecteurs d’aujourd’hui ne sont pas différents. Il est incompréhensible que l’on retraduise, que l’on modifie des classiques comme Le Club des cinq sous prétexte de les rendre plus accessibles (on supprime le passé simple) et de les moderniser (les héros ont des portables mais, comme le boulot est vite et mal fait, ils cognent toujours à la porte d’une ferme pour demander s’ils peuvent téléphoner!). La structure de la phrase s’appauvrit (sujet-verbe-complément) dans un pseudo besoin de se mettre au niveau supposé des enfants lecteurs. En fait avec cinq cents mots on peut faire le journal de midi de TF1 et l’œuvre de Simenon. Tout dépend des mots et de l’usage qu’on en fait… Regardez ce qu’on peut faire avec moins de dix notes!
Non, je ne me sens pas plus responsable. Oui, mon écriture est différente, c’est évident. Pas mal de gens que je rencontre autour du monde de l’enfance me disent «Vos bouquins sont compliqués, leur structure, retours en arrière, vocabulaire, construction…» Mais c’est ma manière et ça a l’air de passer, Le Chat de Tigali qui est presque devenu un classique contemporain le montre. La principale différence que je vois, quand j’écris pour Syros ou Rue du Monde, c’est que mon écriture est plus métaphorique et beaucoup plus poétique. Des problèmes que je résous par les dialogues ou d’autres procédés dans mes livres pour adultes, là je les résous par un autre travail sur le langage. C’est aussi en partie le résultat de mes souvenirs de mes lectures enfantines. Les livres lisses n’ont pas laissé de trace, les livres où il y avait d’un seul coup irruption d’incompréhension, d’inconnu sont ceux qui sont restés; des livres compliqués, des phrases sibyllines, des mots dont on se demande ce qu’ils veulent dire… Le mystère n’est pas simplement dans l’intrigue, il est aussi dans les mots, les phrases, la langue. C’était pour moi un bonheur de découvrir l’Inde, Madagascar ou d’autres contrées par des contes et légendes où apparaissaient des mots pratiquement imprononçables pour le gamin que j’étais. À l’occasion de ces lectures, je découvrais, et je pense que les lecteurs d’aujourd’hui ne sont pas différents. Il est incompréhensible que l’on retraduise, que l’on modifie des classiques comme Le Club des cinq sous prétexte de les rendre plus accessibles (on supprime le passé simple) et de les moderniser (les héros ont des portables mais, comme le boulot est vite et mal fait, ils cognent toujours à la porte d’une ferme pour demander s’ils peuvent téléphoner!). La structure de la phrase s’appauvrit (sujet-verbe-complément) dans un pseudo besoin de se mettre au niveau supposé des enfants lecteurs. En fait avec cinq cents mots on peut faire le journal de midi de TF1 et l’œuvre de Simenon. Tout dépend des mots et de l’usage qu’on en fait… Regardez ce qu’on peut faire avec moins de dix notes!
Propos recueillis par Gégène